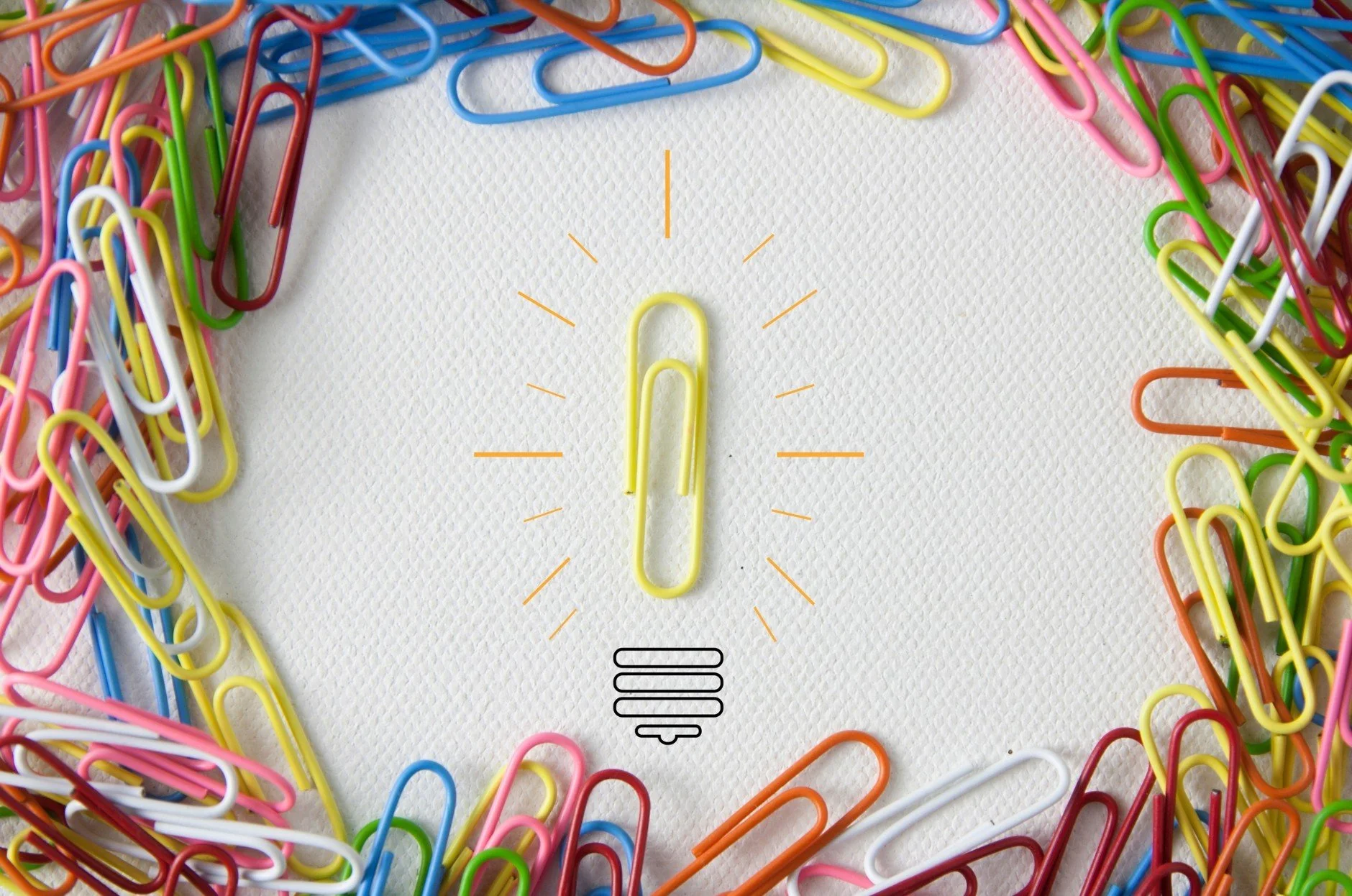De la compétition à l’autonomie : repenser l’individualisme en éducation
Auteure : Éléonaure Crête-Lépine
Les cultures occidentales, à la différence des cultures orientales, accordent une plus grande importance à l’individualisme, ce qui influence directement les approches éducatives. Cette réflexion examine l’impact des deux formes d’individualisme — vertical et horizontal — sur la motivation et les stratégies d’apprentissage des élèves, tout en soulignant le potentiel du tutorat comme moyen de favoriser l’autonomie plutôt que la compétition. [1]
Différence entre individualisme et collectivisme
L’individualisme repose sur la primauté de l’individu, de ses besoins et de ses désirs personnels. Il s’agit d’une vision qui valorise l’autonomie et l’affirmation de soi. Dans ce contexte, l’apprentissage tend à s’appuyer davantage sur la compétition, la comparaison sociale ainsi que sur la liberté d’entreprendre, d’explorer et d’expérimenter.
En revanche, le collectivisme met l’accent sur la priorité accordée au groupe plutôt qu’aux intérêts personnels. L’individu est perçu comme étant étroitement lié aux autres, et l’apprentissage se fonde davantage sur le respect de l’autorité, la conformité, la coopération et le partage. Dans ce texte, nous porterons une attention particulière à l’individualisme. [2]
Effet de l’individualisme vertical sur l’apprentissage
Il existe deux formes d’individualisme, dont la première est l’individualisme vertical. Celui-ci met l’accent sur la compétition et, dans le contexte scolaire, se manifeste par un classement des élèves en fonction de leur performance, avec des récompenses attribuées uniquement à une minorité. Ce type de système favorise la rivalité sociale entre les élèves et a une influence significative sur leur motivation et leur expérience scolaire. Les recherches suggèrent que ce mode de fonctionnement encourage les élèves à adopter des buts de performance, c’est-à-dire à viser la supériorité sur les autres et à démontrer leurs compétences de manière comparative.
Ces objectifs de performance sont souvent associés à deux types de stratégies d’étude. La première est une approche superficielle, comme l’apprentissage par cœur ou la tentative de deviner les sujets d’examen. La seconde est la triche, car dans une logique de performance, certains élèves peuvent être tentés d’atteindre leurs objectifs par n’importe quel moyen. En outre, la poursuite de buts de performance peut engendrer des réactions défensives lors de désaccords, ce qui nuit à l’apprentissage et à l’ouverture d’esprit.
Enfin, les établissements qui valorisent fortement ces objectifs de performance tendent à voir un bien-être plus faible chez leurs élèves. Ce type d’approche semble donc favoriser des stratégies d’apprentissage moins efficaces et moins durables.
Effet de l’individualisme horizontal sur l’apprentissage
L’autre forme d’individualisme est appelée individualisme horizontal. Ce courant valorise avant tout l’indépendance et l’autonomie, tout en reposant sur l’idée que tous les individus sont fondamentalement égaux. Dans un contexte d’apprentissage, cela se traduit par une mise en valeur de la liberté individuelle d’entreprendre, d’explorer et d’expérimenter. Les élèves accorderont ainsi une grande importance à leur autonomie.
On considère que plus un environnement d’apprentissage soutient cette autonomie, plus les élèves seront motivés intrinsèquement par les activités qu’ils réalisent. Cette motivation a des effets positifs sur leur persévérance face aux défis, leur créativité et leur bien-être général. Dans cette perspective, la liberté individuelle occupe une place centrale. Les approches pédagogiques associées à l’individualisme horizontal encouragent donc les élèves à se développer par eux-mêmes, en favorisant leur autonomie et leur engagement personnel.
Dans les systèmes scolaires actuels
Il est toutefois essentiel de souligner que, dans les systèmes scolaires actuels, l’individualisme vertical tend à être davantage valorisé que l’individualisme horizontal. Même si les enseignants tiennent un discours qui ne met pas en avant la réussite au détriment des autres, le fonctionnement même du système continue, de façon plus indirecte, à encourager cette forme de motivation compétitive.
Cela dit, il ne faut pas nécessairement considérer cette approche de manière négative. Lorsqu’on offre aux élèves la possibilité de faire des choix et qu’on les encourage à exprimer leur point de vue, on favorise le développement de leur autonomie, ce qui peut renforcer leur intérêt et leur engagement dans les activités scolaires.
Effet de l’accompagnement personnalisé selon le contexte
Le tutorat vise à accompagner l’apprentissage de l’élève à travers un soutien personnalisé offert en dehors des heures de cours, tout en s’appuyant sur les contenus abordés en classe. Il requiert de l’élève une certaine autonomie, notamment dans la gestion de ses rencontres et dans la communication avec son tuteur pour exprimer ses difficultés ainsi que les aspects qu’il souhaite approfondir.
Le tutorat privilégie des exercices conçus en fonction des besoins particuliers de l’élève et s’appuie sur un retour régulier de sa part afin d’adapter les approches pédagogiques, dans le but de maximiser sa compréhension et de soutenir son intérêt. Se déroulant généralement en tête-à-tête, le tutorat élimine toute forme de compétition, en mettant l’accent sur le développement du sentiment de compétence de l’élève.
En ce sens, le tutorat permet de mobiliser les aspects positifs valorisés dans une société individualiste, en soutenant activement la motivation personnelle à apprendre.
Conclusion
Ainsi, l’individualisme peut influencer l’apprentissage de manière très différente selon la façon dont il est intégré aux pratiques éducatives. Dans ce contexte, le tutorat se présente comme une solution concrète pour valoriser les bénéfices de l’individualisme horizontal, et ce, même au sein de systèmes scolaires qui tendent à privilégier l’individualisme vertical. En adoptant cette perspective, il devient possible de mieux accompagner le développement personnel et scolaire des élèves, tout en les préservant d’une dynamique de compétition permanente.
[1] Dambrun, M. et Darnon, C. (2009). L’individualisme et le collectivisme dans les pratiques éducatives : le ying et le yang ? https://doi.org/10.3406/diver.2009.3067
[2] Usito. (s. d.). Individualisme. https://usito.usherbrooke.ca